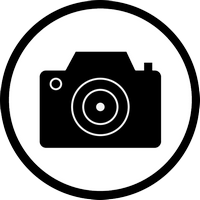« Rien n’est simple dans ce pays qui cultive les apparences de la simplicité »
La Mongolie. Connue en Occident pour être le pays du « grand ciel bleu« , le Tengri. Adulée pour la magnificence de ces immenses paysages variés. Prisée pour la façon de vivre et le savoir faire ancestral des pasteurs-nomades, via l’élevage. Ponctuée par les gers, l’habitat traditionnel de ces éleveurs. Fantasmée pour le sentiment de liberté et d’authenticité que représente la vie au cœur des steppes ; celles qui fascinent tant les touristes… Ce pays revêt d’autres réalités. Notamment celle de la surpopulation urbaine dont Ulaanbaatar (UB), capitale mongole signifiant Héros Rouge, non adopté en 1924 lors de la proclamation de la République populaire, incarne le visage.
Depuis l’âge du Bronze, soit trois mille ans avant notre ère, le système culturel et économique de la Mongolie reposait sur une société basée sur le nomadisme, « le pastoralisme mobile » pour citer Caroline Humphrey et David Sneath. Où l’homme se consacre à une activité extérieure, dans une interdépendance avec son biotope. Sans prendre possession de la terre, qui appartient « au maître des lieux« , il s’occupe du troupeau -élevage extensif d’ovins, caprins, bovins, équidés et camélidés. Il revêt également une implication publique via la communauté. Parallèlement, la femme est tournée vers l’intérieur afin de répondre aux activités domestiques : quête d’eau et du combustible, traite, cuisine, ménage, libation, éducation des jeunes enfants…
Tantôt sous domination de la Chine, tantôt aux mains de la Russie soviétique le système n’a cessé d’évoluer. « En 1929, les autorités mongoles, secondées par les Soviétiques, décidèrent de procéder à la collectivisation du bétail. Censée moderniser et dynamiser l’élevage, cette réforme devait permettre de soutenir le développement du jeune Etat socialiste mongol, en dégageant des surplus agricoles susceptibles d’être exportés ou transformés par une industrie encore embryonnaire », explique l’anthropologue Laura Nikolov. À cette période des terres sont cultivées dans la région du Selenge, la production est exportée afin d’approvisionner l’état russe. L’ensemble de ces bouleversements ont transformé la structure de la société nomade tout au long des 19 et 20ème siècles. Les projets de modernisation se faisant ont souvent été associés à des politiques de sédentarisation, avant que la disparition de l’URSS en 1989, n’ouvre une nouvelle phase de transformation marquée par l’adoption d’une idéologie capitaliste.
Sur un territoire vaste comme trois fois la France. Peuplée en 2019 de 3 millions 200 mille habitants, UB, qui s’étend sur près de 350 km2, accueille aujourd’hui la quasi moitié de la population totale du pays, faisant de celle ci une capitale surpeuplée. En 1918 la ville comptait 20 000 habitants. 10 000 ménages migrent chaque année des zones rurales vers les faubourgs de la ville ; à la recherche de meilleurs moyens de subsistances. «La capitale mongole n’était pas la destination privilégiée de l’exode rural durant la période socialiste, car d’autres agglomérations proposaient des services et un confort urbain comparables. Aujourd’hui, Oulan-Bator concentre l’essentiel des services administratifs, sociaux, éducatifs et médicaux de qualité », selon les données de l’anthropologue Gaelle Lacaze. L’objectif final est identique bien que leur chemin respectif soit singulier. Atteindre la capitale, pôle d’attraction du pays.
Ces néo-citadins affluent des quatre coins de la Mongolie, en provenance de diverses régions : Ömnögovi, Bayan Hongor, Dornod, Uvs… Ils viennent s’échouer, souvent illégalement, au cœur des gers horoolol (quartiers de yourtes) sur les flancs des collines au nord. Celles au sud revêtissent un caractère sacré. Ce qui donne à cette partie de la ville des allures de bidonvilles. Pour y accéder, il faut emprunter des chemins escarpés, poussiéreux et jonchés de trous. Derrière les palissades de bois au cœur des khashaa (foyers urbains), les gers et les maisons de fortune bâtis en dur aux toits en tôles multicolores s’amassent. Telle une mosaïque d’infortunés. Où seul les aboiements des chiens viennent briser le silence. Le grincement des portes en métal, ornées de valeur symbolique, permet de pénétrer chez l’habitant, accueilli par un chien enragé tenu en laisse.
Les infrastructures publiques et collectives manquent considérablement pour ces habitants. Dépourvus de tout droit. Il leur est interdit de se raccorder au réseau électrique ou de faire ausculter leurs nouveaux nés. Délaissés des services gouvernementaux urbains. Ils sont confrontés à des problèmes de distribution et d’accès à l’eau potable, à l’électricité, pas de place dans les écoles. Ici aucun foyer ne possède l’eau courante ou le tout à l’égout. Souvent, le puits ou les points d’eau se situent à plusieurs centaines de mètres du khashaa. Les rues sont le théâtre d’un ballet de chariots tirés par les enfants chargés de ramener de l’eau chaque jour. L’hiver, l’air est irrespirable du fait des milliers de gers chauffées au charbon. La plus forte pollution recensée est due à la combustion de charbon, 40% de la pollution annuelle d’UB incombe au chauffage des gers, et aux nombreuses particules toxiques retrouvées dans les fumées des cheminées des grandes centrales thermiques produisant les chauffages urbain de la ville. La pollution des eaux, du sol et de l’air par la dioxine et les métaux lourds revêt un constat alarmant ! Chez les nouveaux nés des malformations infantiles sont recensées. Loin des anciens immeubles soviétiques ou des nouveaux bâtiment flamboyants de l’ère capitaliste qui pullulent dans le centre. Seule la fracture sociale entre ces deux espaces urbains reste à observer.
Bien que le phénomène de gers horoolol ne soit pas nouveau. Il s’est considérablement intensifié depuis l’entrée de la Mongolie dans l’économie libérale en 1990, amplifié par l’industrie minière. Aujourd’hui 60% des habitants de la capitale y vivent. Pauvreté, chômage, misère, alcoolisme et insécurité y règnent. Avant leur sédentarisation, ils étaient, pour la plupart, éleveurs pasteurs ; par conséquent ils n’ont pas de connaissance autre que celles apprises via cet héritage immatériel. Certains, à la suite de zud (« Catastrophe naturelle d’origine climatique, liées à la variabilité saisonnière et interannuelle des températures et des précipitations, qui causent d’importantes pertes en bétail, selon les anthropologues Charlotte Marchina & Gaëlle Lacaze) meurtrier ou d’épizootie, engendrant la perte totale ou partielle du cheptel, ont fui la steppe, les montagnes. D’autres se sont installés, souvent à contre cœur, pour des raisons sanitaires, sociales et culturelles. Pensant idéalement que leur progéniture pourrait avoir accès à l’éducation et que toute la famille bénéficierait de soins médicaux et des hôpitaux.
Comme le constate Marc Alaux « davantage de gens sont mal logés et ont faim qu’à la période communiste, ce qui fait regretter les salaires réguliers, l’emploi pour tous, les retraites, la scolarisation et la médecine gratuites de l’époque » à travers les pages de son ouvrage « Sous les yourtes de Mongolie. Avec les Fils des steppes ».
L’ère soviétique effondrée, l’agriculture planifiée abolie, la chute de la production maraichère contribuent au changement de meurs depuis les années 1990. À cette époque il était quasiment impossible de trouver des légumes frais en ville ; n’étant pas l’aliment traditionnel de base. Qui repose sur une alimentation carnée et laitière. Comme en témoigne Ounarach, 45 ans, arrivée à UB depuis la région d’Ömnögovi en 1992 « on ne trouvait que de la viande et de la farine, c’était très difficile, voir impossible de trouver des légumes », elle réside dans le horoolol de Khan-Uul à 30 kms à l’est du centre ville. Bien que ces dernières années la consommation ait augmenté, elle reste insuffisante pour parler d’alimentation équilibrée. L’agriculture fait partie des derniers secteurs financés par le gouvernement, avec 104 166 000T (35 477€) alloués. En sachant que 80% de la production agricole provient de l’élevage, textile compris. La part s’avère mince pour la fabrication de légumes. Loin derrière l’investissement étatique des mines, qui représente presque la moitié du budget total.
Une amélioration est cependant notoire. Toutefois les produits ont encore du mal à se diversifier ; les aliments phares sont toujours les mêmes sur l’ensemble du pays: patates, carottes, choux, navets et oignons; communément dénommés les « légumes d’hiver ». Leur acheminement est également problématique. Les légumes frais cultivés dans les zones rurales regagnent les consommateurs via des intermédiaires ce qui réduit la qualité et la profitabilité de production. La Mongolie produit 54% des légumes. Selon le Ministère de l’Agriculture, on évaluait à 23 000 tonnes le nombre de production des cultures sur l’ensemble du territoire en 1996. On parle de 100 000 tonnes pour l’année 2018. Ces chiffres ne tiennent pas compte de la culture de la patate pour laquelle le pays est autosuffisant. Les 46% manquants sont importés des pays voisins : Chine et Russie. Ces derniers coûtant moins chers mais étant de moins bonne qualité. Les régions d’où émanent la production sont Tuv : 35% autour d’UB et Selenge 75%.
Pour ce peuple d’éleveurs, la culture du sol englobe un apprentissage soumis à d’autres codes. Un ensemble de savoir et savoir faire à acquérir. Une nouvelle façon de penser ; qui implique le fameux « brock your brain » (processus de déconstruction de la mentalité et du poids de la tradition), tel que le relate Lhagvasuren Lhagva, ancien diplomate qui a constitué en 2017 un laboratoire de cultures dans la région du Dornod. Pour pallier à des besoins vitaux et de premières nécessités, tel que se nourrir, certaines associations comme l’ADRA ont initié des familles, « dans le besoin » souligne Bronwyn (en charge du Meal Project), à la confection de potager afin de leur rendre une part d’indépendance, d’autonomie. Via le « Meal project » institué en 2012, qui s’inscrit dans la politique gouvernementale de promotion du maraichage, ayant pour objectif de tendre vers l’auto-suffisante alimentaire au cœur des gers districts. En 2018, 1 100 familles étaient bénéficiaires de ce projet, recrutées avec leur consentement, par le chef du district, entité administrative. À ce jour, 100 personnes sont devenues des référents jardiniers, en plus de posséder un jardin ils s’occupent de coordonner les autres volontaires et/ou bénéficiaires dans leur secteur. Ce qui suscite la responsabilisation de cette communauté et développe parallèlement une connexion sociale importante. Loin de la solitude qui existe en campagne.
D’autres, à l’image des autorités locales du district de Nalaikh, éloigné de 40 kms du centre de UB vers l’est, ont institué volontairement depuis 2014, en partenariat avec l’ONG Suisse Agency for Development and Cooperation (SDC) via le Mongolian Vegetable Program, « le développement de légumes afin de lutter contre le chômage, croissant suite à la fermeture des mines, et pour favoriser une alimentation plus saine et diversifiée » explique Khongorzul. Leur champ d’action est localisé sur le 7ème khoroo pour « plus de durabilité et d’efficacité ». De façon à aider un groupe d’individus vivant au même endroit au lieu d’en aider plusieurs individuellement. Un système d’irrigation, le long de la rue, a été mis en place pour approvisionner les jardiniers de ce secteur.
L’apprentissage, pour ces novices, s’effectue selon plusieurs étapes.
Identifier les légumes et définir l’origine des graines. Spécialement pour les nouveaux légumes et condiments cultivés tels que les artichauts, épinards, laitues, betteraves, brocolis, tomates, concombres, cornichons, poivrons, ail, persil, aneth, basilic, menthe qui poussent sous des serres tunnels ou passives solaires afin d’étendre la période de culture.
Les faire pousser et reconnaitre les maladies. Ce qui implique patience, attention, technique. Dejid réside à Nalaikh, dans le 3ème khoroo, elle a commencé de façon volontaire et décriée par sa famille à cultiver en 2010, elle avait 27 ans. L’association World Vision lui avait fourni 20kgs de graines de patates. Au moment de semer elle « n’a pas voulu écouter les instructions des donateurs », elle n’a donc rien récolté. Sa détermination et sa ténacité l’ont poussé à réitérer l’année d’après. Cette fois ci elle a suivi les recommandations « centimètre par centimètre, mètre par mètre ». Elle s’est rendue compte de l’importance indéniable et primordiale que revêt l’acquisition de la méthodologie. Sa récolte fut fructueuse ce qui l’a encouragé à poursuivre sur ce chemin en diversifiant sa production. Son audace et sa créativité lui permettent d’innover. Elle confectionne des plats à emporter uniquement à base de légumes, « pour inciter les voisins à en consommer facilement ». À ce jour, les revenus de la famille, composée de cinq personnes, émanent exclusivement du maraichage, ce qui lui a valu l’obtention l’année dernière d’une médaille délivrée par le gouvernement.
Apprendre à les cuisiner, par l’intermédiaire de cours de cuisine, proposés par les associations ou impulsés par certains volontaires à l’âme de cuisinier. Si les jardiniers du « Meal Project » ont un surplus de légumes. Possibilité de les vendre à travers un réseau de « selling point ». Ces points de vente, un container rehaussé par des parpaings ou des pneus, positionnés en bord de route, sont au nombre de deux par district, chaperonnés par des bénévoles. Au total on en dénombre dix dans les gers horoolol, essaimés dans les cinq districts du nord. Ils sont fonctionnels de juillet à septembre, pendant la période de récolte.
Le jardinage domestique ou urbain reste une opportunité, en particulier, pour les femmes sans revenu. Bien qu’il ne représente pour le moment dans la plupart des cas que 20% du salaire. Les dépenses alimentaires sont réduites, le surplus est vendu par le biais de réseau familial, professionnel ou associatif, et la consommation de légumes dans l’alimentation familiale s’améliore ; bénéfique d’un point de vue sanitaire. Ces néo-citadins devenus au gré du temps, à force de travail et d’opiniâtreté, les maraichers d’aujourd’hui, sont encore trop souvent des femmes, d’une tranche d’âge allant de 40 à 60 ans. La jeune génération est attirée par les nouvelles technologies et le secteur de développement du pays, en somme tout ce qui attrait au progrès. Bien que différent et éloigné de leur culture traditionnelle, ils sont d’accord pour évoquer le fait que « cultiver les légumes n’est pas une tâche difficile en soi ». Quand certains rêvent de retourner respirer l’air frais des steppes, l’utopie s’invite. Sans argent il n’y a pas d’acquisition de cheptel et sans bétail aucun retour possible. D’autres affirment qu’ici leurs conditions de vie sont meilleures, qu’elles se sont améliorées. Ce qui laisse songeur sur la réalité de la dureté de leur vie dans la campagne prisée. La problématique de l’environnement, avec un sol et l’air pollués, reste préoccupante. Toutefois, il s’avère important de notifier l’émergence de ce mouvement. Une nouvelle impulsion. Rien n’est acquis, tout est en construction, en devenir, voué à s’améliorer. Comme le dénote Tulga, agronome-conseiller pour l’ADRA ; « ce projet consiste au mouvement des jardiniers dans les gers districts. Il y a six ans, au début, on ne savait pas quelle ampleur cela allait prendre. En 2018, il devient très important. Maintenant les bénéficiaires peuvent avoir une sécurité alimentaire. Ainsi qu’une communauté de jardiniers dans la ville d’UB. Ce qui rend également la ville verte. Nous voulons continuer dans ce sens, le développer. Nous en sommes encore à un stade embryonnaire ».
C’est à l’unisson qu’ils avouent, un sourire esquissé au coin des lèvres, qu’ils accompagnent toujours leur mets d’un peu de viande…le mouton et son gras emblématique gardent leur place émérite même loin des pâturages, au même titre que le succulent et immanquable süütei tsai (thé au lait). Ce qu’affirmait l’anthropologue Sandrine Ruhlmann « manger, pour un Mongol, c’est manger chaud un plat de viande ».